Nouveaux articles
René LATOUCHE
À la mémoire de mon ami René Latouche
Telle
est la dédicace, en 1928, de Les Conquérants, deuxième des
trois ouvrages promis en janvier 1925 à Bernard Grasset. Dans
l’édition de la Pléiade une note (p. 1034) présente ce
Latouche :
Malraux en
1920-1921 fut très lié à cet ami que lui avait fait connaître
Georges Gabory. Selon Jean Lacouture, cet employé de bureau,
boiteux, de Clichy-la-Garenne, rêvait de littérature. Il n'avait
pas vingt ans quand il se laissa un jour, à Saint-Malo, submerger
par la marée. Malraux se fâcha ensuite avec Gabory à cause de la
manière dont ce dernier a raconté dans Les Enfants perdus le
suicide de leur ami commun. La dédicace des Conquérants
montre que sept ans après Malraux n'avait pas oublié.
Cette
présentation est fort succincte. Voyons si nous ne pouvons pas en
savoir plus. Pour cela, lisons ou
relisons Georges Gabory (voir TH Gabory). Nous
avions lu en 2006 Apollinaire,
Max Jacob, Gide, Malraux & Cie,
d’abord sous
l’angle de la sexualité d’André Malraux, mais
nous avions trouvé l’ouvrage
passionnant de bout en bout. Nous
avions en
particulier relevé un
souvenir émouvant sur Greta Prozor, celle
qui a été si magnifiquement
portraiturée par Henri Matisse.
Revoyons donc l’affaire René Latouche, au chapitre IV :
La véritable histoire de René
Latouche et des Malraux (à Jean Lacouture).
En voici les extraits principaux,
détachements
justifiés par le style
narratif émietté et discontinu
de Gabory :
Je
fis bientôt, par ricochet, la connaissance d'un de ses amis, Georges
M., son confident ordinaire, et celle d'un autre de leurs amis à
tous les deux, René Latouche...
Nous
posions un peu l'un devant l'autre. Faire de la littérature, être
poète et se voir imprimé tout vif, privilège enviable...
Il
était boiteux et clochait fortement d'une jambe ; cette infirmité
acquise ou congénitale ne semblait pas lui avoir donné ce qu'on
appelle aujourd'hui un « complexe d'infériorité ». Jeune et plein
d'entrain, il se défendait...
Ainsi
[Malraux] fut-il le parrain de l'héroïne des Enfants perdus,
où je reprenais le projet auquel j'avais renoncé provisoirement -
après la mort de René Latouche, dont je me croyais coupable, avec
Malraux lui-même, à qui j'avais eu la faiblesse de le présenter...
Malraux
manquait de discrétion et de franchise. En me demandant de lui
présenter René Latouche, il avait voulu mettre un commun diviseur
entre nous - « diviser pour régner » - sur le tiers inclus c'était
facile et René ne demandait qu'à devenir le satellite obscur d'un
astre éblouissant...
Un
autre se perdit sans retour et j’avais contribué à sa perte. Avec
moi, René Latouche ne courait pas grand risque, mais avec Malraux
qui ne prenait rien ni personne au sérieux, hormis « ce monstre
incomparable et préférable à tout », le monstre sacré que chacun
adore en soi-même ? Envoûté, fasciné par l'attitude et les
discours de son nouveau maître, René aussi le prenait au sérieux,
pour son malheur...
Pauvre
René ! Ses illusions s'envolaient l'une après l'autre. Il
avait quitté son bureau, persuadé que le tout-puissant « André »
lui trouverait une sinécure, un job, hélas ! Il ne voyait rien
venir...
J'avais
reçu un mot de René, un dernier mot : Amitiés, écrit au
verso d'une carte postale en couleurs représentant un paysage de la
côte normande.
Accident,
crime ou suicide ?
Un
voyageur sans bagage, un jeune homme, était arrivé le soir à
Saint-Valéry-en-Caux (Seine-inférieure). Il avait pris et payé
d'avance une chambre dans un hôtel en donnant un faux nom (je l'ai
oublié) et une fausse adresse, 14, rue Brunel, Paris XVIIème -
l'adresse de Malraux, suprême hommage ou reproche. Le lendemain on
trouvait son corps sur la plage où la mer l'avait rejeté. La police
ayant découvert aisément l'identité du défunt (il était boiteux,
signe particulier), sa mère était venue le reconnaître. - « Elle
t'en veut, tu sais », me dit le frère de Nénette en m'apprenant la
nouvelle. Je ne lisais pas les journaux et je relevais de maladie. Il
y avait de quoi m'en vouloir en effet. Je portais le chapeau.
Un
dimanche, à midi avec René, nous avions bu chacun trois amourettes
au comptoir du café-tabac qui faisait le coin du boulevard National
et de la rue des Bois. Les mauvaises fréquentations. René rentrait
tard, ne travaillait plus, il avait perdu sa place - dans la vie...
Et
le lendemain, dans tes bureaux du Petit Parisien, devant la
photo du noyé, je n'étais pas fier, homicide par imprudence et par
sottise, et Malraux ? Je ne suis pas certain de lui avoir dit
cette phrase pathétique et « midinette » (les Enfants perdus,
p. 97) : - « C'est nous qui l'avons tué ». De toute façon,
il ne voulait rien entendre et rien savoir...
Un
cadavre, entre amis, c'est gênant - du moins, pour moi, c'était
gênant. La mort de René Latouche m'avait ouvert les yeux.
R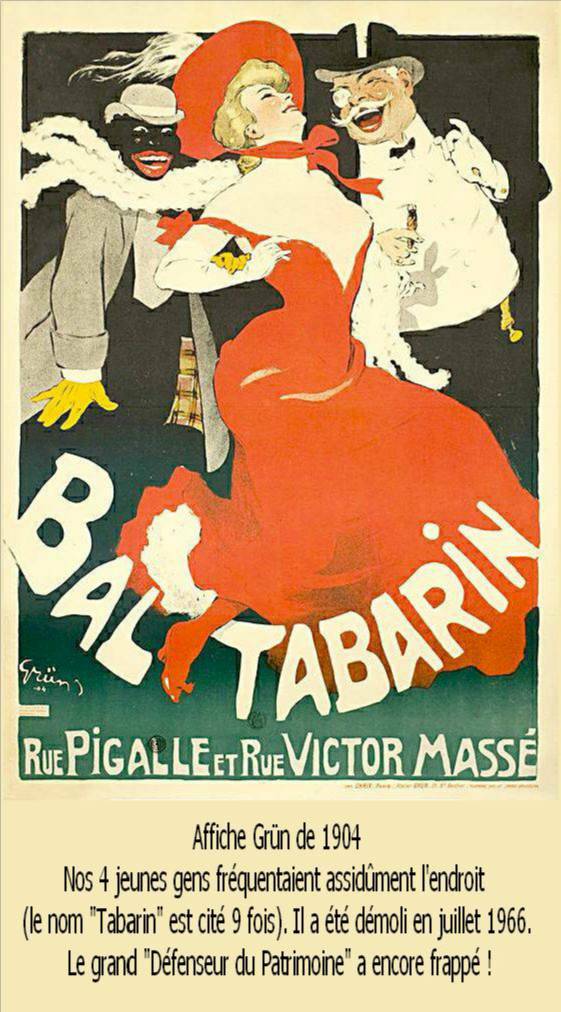 ésumons :
Vers 1920 Gabory
et Malraux ont rencontré et subjugué un jeune homme confiant
et crédule. Ils lui ont fait croire à une aide littéraire et à un
emploi. Se voyant trompé, en 1921
celui-ci s’est suicidé. Après
sa mort, Gabory, hanté
par le remords, a raconté
l’histoire dans un roman (« d’où
la malveillance n’est pas exclue » selon Vandegans, p. 50 de
son ouvrage),
Les Enfants perdus
(nrf, Gallimard, 1923).
Il est bien conscient d’y avoir
modifié quelque peu
la réalité : On
écrit, on se laisse entraîner. Dans les
Enfants perdus
j’ai brodé sur les derniers jours de René.
Cependant, lisons-le.
ésumons :
Vers 1920 Gabory
et Malraux ont rencontré et subjugué un jeune homme confiant
et crédule. Ils lui ont fait croire à une aide littéraire et à un
emploi. Se voyant trompé, en 1921
celui-ci s’est suicidé. Après
sa mort, Gabory, hanté
par le remords, a raconté
l’histoire dans un roman (« d’où
la malveillance n’est pas exclue » selon Vandegans, p. 50 de
son ouvrage),
Les Enfants perdus
(nrf, Gallimard, 1923).
Il est bien conscient d’y avoir
modifié quelque peu
la réalité : On
écrit, on se laisse entraîner. Dans les
Enfants perdus
j’ai brodé sur les derniers jours de René.
Cependant, lisons-le.
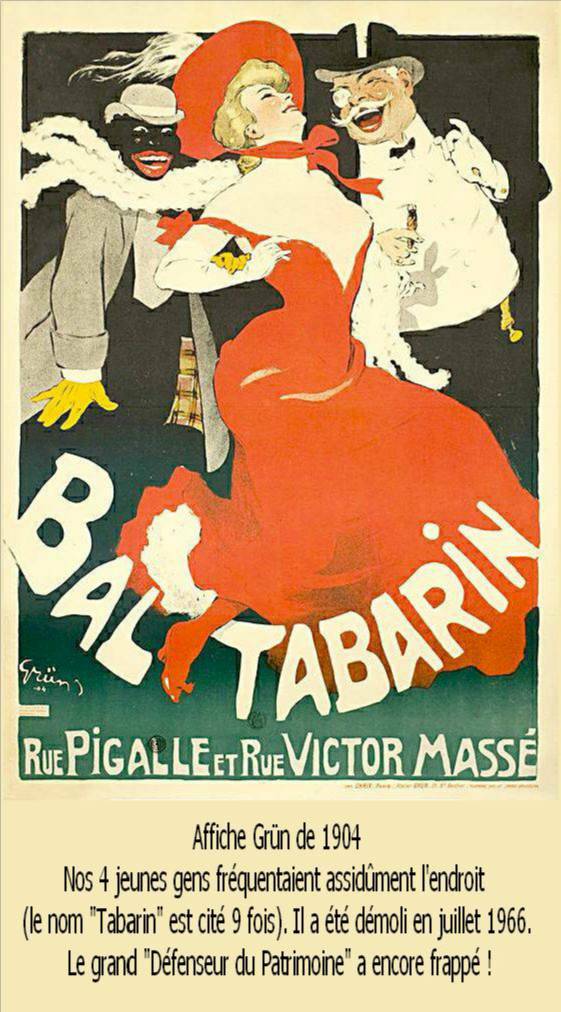 ésumons :
Vers 1920 Gabory
et Malraux ont rencontré et subjugué un jeune homme confiant
et crédule. Ils lui ont fait croire à une aide littéraire et à un
emploi. Se voyant trompé, en 1921
celui-ci s’est suicidé. Après
sa mort, Gabory, hanté
par le remords, a raconté
l’histoire dans un roman (« d’où
la malveillance n’est pas exclue » selon Vandegans, p. 50 de
son ouvrage),
Les Enfants perdus
(nrf, Gallimard, 1923).
Il est bien conscient d’y avoir
modifié quelque peu
la réalité : On
écrit, on se laisse entraîner. Dans les
Enfants perdus
j’ai brodé sur les derniers jours de René.
Cependant, lisons-le.
ésumons :
Vers 1920 Gabory
et Malraux ont rencontré et subjugué un jeune homme confiant
et crédule. Ils lui ont fait croire à une aide littéraire et à un
emploi. Se voyant trompé, en 1921
celui-ci s’est suicidé. Après
sa mort, Gabory, hanté
par le remords, a raconté
l’histoire dans un roman (« d’où
la malveillance n’est pas exclue » selon Vandegans, p. 50 de
son ouvrage),
Les Enfants perdus
(nrf, Gallimard, 1923).
Il est bien conscient d’y avoir
modifié quelque peu
la réalité : On
écrit, on se laisse entraîner. Dans les
Enfants perdus
j’ai brodé sur les derniers jours de René.
Cependant, lisons-le.Le livre, pourtant assez court (220 pages), comporte en fait 4 histoires. La première et la plus longue (90 pagesi) est celle qui nous intéresse. Elle porte un titre qui a donné son nom à l’ensemble : Les enfants perdus. Elle met en scène 4 jeunes gens : Laurent, Jean-Paul, Roland et Albert, lesquels ne sont autres respectivement que René Latouche, Louis Chevasson, André Malraux et Georges Gabory.
La phrase accusatrice terrible C’est nous qui l’avons tué, que Gabory n’est pas certain d’avoir prononcée, est bien là, mais André Malraux ne s’en émeut pas et, au contraire, il trouve les raisons et arguments qui, pour lui, expliquent le suicide de leur ami :
L'après-midi,
Georges disait à André :
— C'est
nous qui l'avons tué.
— Il
est mort…
— Faute
de savoir vivre, mais nous ne lui avons pas appris.
— Il
y avait trois motifs suffisant à ce qu'il mourût, puisqu'il te faut
des motifs. Il adorait une femme qui le trompait, il voulait écrire
et il n'avait pas de talent, il aimait le luxe et il était pauvre. —
Oui, mais le premier motif n'aurait pas suffi. Qui lui a donné le
désir d'écrire, le goût du luxe, l'habitude de la paresse? Nous,
notre exemple. Ah! je ne peux pas chasser cette pensée : il ne se
serait pas tué s'il ne nous avait pas rencontrés.
— Son
suicide a une cause plus profonde, plus élevée. L'absence de
raisons de vivre, dit André….
On
voit que les arguments d’André Malraux sont rationnels et
probants. La fâcherie avec Georges Gabory s’explique donc
difficilement par la manière dont ce dernier a
raconté
dans Les Enfants perdus
le suicide de leur ami commun, comme le prétendent la Pléiade et
quelques autres. La brouille ne
serait-elle
pas causée plutôt
par le regard critique porté sur son comportement ?
… enfin
une scène, mes amis, une scène avec cris, larmes et tout le
tremblement…
— Qui
est le meilleur de l'homme, comme a dit Goethe.
— Et
le pire de la femme, comme vous savez, messieurs, acheva André qui,
à l'occasion, se montrait volontiers misogyne. (p. 15)
— La
vie est courte.
— Oh!
non, interrompit André qui s'imaginait être revenu de partout où
il n'était jamais allé et dont la plus chère croyance était de ne
rien croire.
...
Mais autre chose, messieurs, j'ai obtenu quelques louis de mon
estimable éditeur. Nous dînons ensemble demain soir chez Marguery,
si vous voulez, ensuite Tabarin, ensuite restaurant de nuit ou
cabaret mal famé. (pp. 19-20)
Il
avait rencontré André à la Bibliothèque.
André préparait une Mythogie pour un éditeur juif qui, à son
avis,
dépassait Shylock en avarice et eût coupé sur le sein du débiteur
non pas la livre de chair de la créance, mais une livre et demie !
(pp. 22-23)
L'un
et l'autre tenaient à ne pas céder. Ils mesuraient leur âme.
Chacun
d'eux préférait la sienne et, lorsqu'ils se furent quittés, chacun
d'eux se croyait supérieur à son nouvel ami. André n'appréciait
que l'intelligence. L'amour, la pitié lui semblaient bas, cependant,
c'était avec une conviction enthousiaste qu'il doutait de tout.
(pp. 24-25)
Georges
avait présenté René à André à qui Louis était lié depuis
longtemps. Louis était employé de commerce, René courtier
d'assurances. Ils cachaient leur profession. Bien que André fût
d'une famille
assez riche, ses ressources provenaient de petits travaux d'érudition
à faire chez soi et qu'il faisait ailleurs. Il aimait à traiter ses
amis dans les restaurants élégants. Fier, généreux et
prodigue avec un peu d'ostentation, il voulait qu'on le vît ouvrir
les fenêtres par où il jetait l'argent. (p. 25)
Ce
soir-là, René rapportait à Georges ce que André lui avait dit des
femmes et de l'amour. L'amour ? Un mirage. Les femmes ? Des
sujets. Les sentiments ? Des expériences ou des habitudes. On ne
pouvait pourtant plus croire à l'amour ni prendre les femmes au
sérieux. (p. 66)
La
demoiselle était une habituée de Tabarin, elle y avait vu la
maîtresse d’André.
— Loulou?
Une petite blonde avec un nez en l'air?
— Pas
précisément, dit André, enchanté de cette méprise, elle est très
brune et elle a plutôt un type sémite… (p. 83)
André
montrait une gaîté amère et affectée. Il refusa d'aller à
Tabarin, ayant peur d'y rencontrer sa maîtresse, qu'il venait de
quitter.
— Et
puis, dit-il, tu sais que je vais me marier.
— Ah
! répondit Georges, je te félicite. Et il se rappela immédiatement
la misogynie de André, ce qu'il disait du mariage autrefois (un mois
avant), mais cette réflexion lui parut méchante. André était
amoureux sans doute et toutes les règles de la vie ont des
exceptions qui peuvent en devenir les règles à leur tour…
(pp. 98-99)
Misogyne,
d’une
parole peu fiable, hâbleur, fanfaron, orgueilleux, pédant, légèrement
antisémite… selon Gabory : André
Malraux ne pouvait certainement
pas admettre dans son entourage un
témoin aussi critique et acerbe
(sans malveillance) de ses paroles
et de ses agissements. Non, la mort
de René
Latouche n’est pour rien dans la brouille entre les deux « amis ».
[L’annonce
de son prochain mariage par André permet de dater précisément les
épisodes du livre par l’année 1921 car André et Clara se
sont épousés le 21 octobre 1921].
© Jacques Haussy, juillet 2021
i Je tiens le livre numérisé à la disposition de qui en fait la demande. À titre gracieux et pour un usage non commercial, bien entendu. Georges Gabory étant mort en 1978, son livre de 1923 n’est pas dans le domaine public – il le sera en 2049, 70 ans après son décès. Les plus de 13 000 mots, au format Libération Serif 12, représentent 10 feuilles A4 recto-verso, 20 pages. Pour en faciliter la lecture et la compréhension j’ai rétabli les prénoms - Albert [Georges] figure 138 fois, Laurent [René] 103, Roland [André] 54 et Jean-Paul [Louis] 20. Comme on voit, André Malraux est loin d’être le personnage principal.

